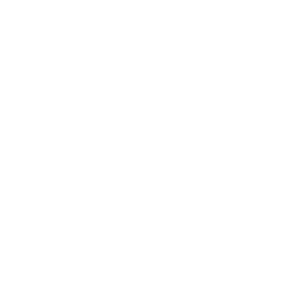Quel est l’impact sur la paix sociale en entreprise de la conjoncture actuelle, des mesures gouvernementales et des discours politiques de droite ou d’extrême droite ?
Une paix sociale sous pression dans un contexte inédit
La paix sociale en entreprise n’a jamais été un simple état de calme apparent. Elle repose sur un équilibre dynamique entre les intérêts de la direction, des travailleurs, des délégués syndicaux et des autres partenaires sociaux, dans un cadre fixé par le droit du travail belge, les conventions collectives de travail (CCT), la concertation sociale et la culture d’entreprise. Or, cet équilibre est aujourd’hui soumis à des tensions multiples : ralentissement de l’activité économique, hausse du chômage (notamment en Wallonie), menaces de sauts d’indexation, mesures d’économies sur les pensions, décisions de limitation de la durée du chômage, menaces de hausse de la TVA ou autres nouvelles charges, perception d’un démantèlement progressif de la sécurité sociale et du marché du travail, ainsi que des discours stigmatisants portés par certains partis de droite ou d’extrême droite à l’égard des bénéficiaires d’allocations sociales et, notamment, des chômeurs ou des malades de longue durée. Les organisations syndicales alertent notamment sur l’impact du « malus pension » annoncé, qui toucherait une part importante des femmes, et sur le durcissement de la flexibilité du travail. Le 14 octobre, entre 80.000 et 140.000 personnes sont descendues dans les rues de Bruxelles pour exprimer leurs inquiétudes. Depuis, d’autres mobilisations ont eu lieu (enseignants, magistrats, secteurs publics…). La fin du mois de novembre s’annonce particulièrement chargée, avec trois journées d’action nationales les 24, 25 et 26 novembre, tandis que le secteur de la chimie, confronté à des négociations salariales et de conditions de travail bloquées, a déjà annoncé des actions spécifiques jusqu’au début décembre 2025. Dans ce contexte, il est raisonnable d’envisager que la paix sociale en entreprise soit mise à l’épreuve. Plutôt que d’annoncer des certitudes, l’enjeu est d’identifier des scénarios plausibles, de comprendre ce qui se passe déjà sur le terrain, et de clarifier ce que peuvent encore faire les entreprises, leurs managers, leurs RH et leurs délégués syndicaux pour préserver un climat social apaisé et une stabilité sociale en entreprise qui soutiennent la performance et la pérennité.
Un contexte économique et politique qui fragilise la paix sociale
Une conjoncture économique en ralentissement
La Belgique traverse une phase de contraction de l’activité dans plusieurs secteurs. La hausse du nombre de chômeurs – avec une augmentation de l’ordre de 10 % en Wallonie – accentue la perception d’un marché du travail plus incertain. Parallèlement, le coût de la vie continue d’augmenter, malgré les mécanismes d’indexation. Pour les travailleurs, cela se traduit par un sentiment d’insécurité socio-économique. Même lorsqu’ils conservent leur emploi, ils peuvent avoir le sentiment que l’ascenseur social se grippe, que les efforts demandés ne sont pas compensés, et que la sécurité sociale qui les protégeait devient plus fragile. Dans ces conditions, la paix sociale ne repose plus seulement sur les pratiques internes de l’entreprise, mais aussi sur la manière dont les salariés perçoivent l’évolution du cadre plus large dans lequel ils vivent.
Mesures sociales sensibles et inquiétude sur l’avenir
Les mesures gouvernementales prises ou envisagées – réformes des pensions, malus pension, économies dans la sécurité sociale, limitation de la durée du chômage, renforcement de la flexibilité, réformes du marché du travail – sont perçues par une partie importante des travailleurs comme des remises en question de droits acquis. Même lorsqu’elles s’inscrivent dans une logique budgétaire ou macroéconomique, elles sont vécues au niveau individuel comme des pertes de sécurité et de visibilité. Dans ce contexte, il est plausible que les travailleurs deviennent plus attentifs à tout ce qui, dans leur entreprise, peut être interprété comme une dégradation de leurs conditions de travail, une intensification de la charge, ou une absence de reconnaissance. La paix sociale se trouve alors exposée à des risques de fragilisation, car la moindre décision interne se superpose à un climat externe déjà chargé.
Discours stigmatisants et polarisation sociale
Les discours politiques stigmatisant les bénéficiaires d’allocations sociales, les chômeurs ou les malades de longue durée contribuent à créer un climat de polarisation. Ils alimentent des représentations simplistes du type : « ceux qui travaillent » contre « ceux qui coûtent ». Même si ces discours ne proviennent pas de l’entreprise, ils ont des effets indirects sur la cohésion interne. Certains collaborateurs peuvent se sentir dévalorisés ou suspectés ; d’autres peuvent adopter des jugements rapides sur des collègues en difficulté. Dans les deux cas, la solidarité au travail et l’esprit d’équipe peuvent s’en trouver affaiblis, ce qui rend la paix sociale plus fragile.
Comment travailleurs et organisations syndicales vivent-ils ce contexte ?
Une vigilance syndicale renforcée
Les organisations syndicales, au niveau interprofessionnel comme sectoriel, interprètent l’enchaînement des réformes et des annonces comme un changement de paradigme social. Elles y voient le risque d’un affaiblissement du modèle social belge, construit sur la concertation sociale, la négociation collective et l’équilibre entre liberté d’entreprise et protection des travailleurs. Il est donc logique qu’elles renforcent leur vigilance dans les entreprises. Cela peut se traduire par des interventions plus fréquentes dans les CE, CPPT, comités de concertation, par une attention accrue au respect des CCT, et par une mobilisation plus rapide lorsque des restructurations, des modifications d’horaires, des intensifications de charge ou des différences de traitement apparaissent.
Des travailleurs sous tension : fatigue, inquiétude et perte de confiance
Du côté des travailleurs, la situation se traduit souvent par une fatigue sociale et une anxiété diffuse. Ils sont pris entre :
- des contraintes économiques qui pèsent sur leurs budgets,
- des décisions politiques qu’ils comprennent parfois mal,
- des transformations du travail (digitalisation, réorganisations, pressions sur la productivité),
- et un discours public qui peut sembler parfois accusateur plutôt que protecteur.
Dans un tel climat, les irritants du quotidien – une remarque maladroite, une consigne mal expliquée, une charge de travail qui augmente, une absence de feedback – peuvent cristalliser des frustrations bien plus larges. La paix sociale ne se joue plus uniquement dans les grandes décisions, mais aussi dans la manière dont les micro-tensions sont gérées au quotidien.
Une mobilisation sociale qui déborde le cadre institutionnel
Les manifestations massives, les actions sectorielles, les journées nationales de grève ou de protestation sont autant de signaux que le climat social global est en train de se tendre. Même si une entreprise n’est pas directement visée, ses travailleurs n’y sont pas indifférents : certains y participent, d’autres y réfléchissent, tous y sont exposés par les médias. La participation de membres du personnel à une action de grève externe à l’entreprise constitue un bon indicateur de la qualité du dialogue social, voir cet article ici. Il devient alors plus probable que les débats politiques et sociaux se transportent, d’une manière ou d’une autre, dans les échanges informels sur le lieu de travail, dans les réunions d’équipe, dans les discussions entre managers et délégués syndicaux. La paix sociale en entreprise ne peut pas être isolée de cette dynamique.
Ce que j’observe concrètement dans les entreprises aujourd’hui
Au-delà de l’analyse générale, mon expérience de terrain – dans des PME, des grands groupes, des organisations privées et publiques – me permet de dégager quelques tendances récurrentes. Dans de nombreuses entreprises, je constate d’abord une accumulation de signaux faibles : plus de remarques sur la charge, plus de plaintes sur le manque de reconnaissance, plus de tensions interpersonnelles entre collègues ou entre équipes, plus de crispations dans les échanges entre managers et délégués syndicaux. Ces signaux sont souvent minimisés ou attribués au “caractère des personnes”, alors qu’ils traduisent une fragilisation globale du climat social. Je vois aussi des managers de proximité qui se sentent pris en étau : d’un côté, une direction qui leur demande de tenir les objectifs dans un contexte difficile ; de l’autre, des équipes fatiguées, inquiètes, qui attendent d’eux du soutien, de la reconnaissance, de la clarté. Faute d’accompagnement, ces managers peuvent adopter des attitudes de retrait, de sur-contrôle ou de défense, qui aggravent malgré eux les tensions. Enfin, j’observe des situations où les délégués syndicaux oscillent entre plusieurs rôles : porte-voix des frustrations, protecteurs des droits, relais de réalités de terrain, mais aussi parfois vecteurs de blocage lorsqu’ils se sentent attaqués, déconsidérés ou instrumentalisés. La qualité de la paix sociale dépend alors fortement de la capacité des uns et des autres à se parler autrement, dans un cadre structuré, sécurisé, respectueux des rôles.
Impacts possibles sur la paix sociale en entreprise : des risques à prendre au sérieux
Sans prédire l’avenir, il est possible de formuler plusieurs hypothèses raisonnables quant aux impacts de ce contexte sur la paix sociale en entreprise. Il est plausible, d’abord, que la sensibilité sociale augmente. Dans les réunions de travail, les CE, les CPPT, les réunions d’information, les questions deviennent plus nombreuses, plus insistantes, parfois plus émotionnelles. Les collaborateurs sont plus attentifs aux incohérences perçues, aux décisions unilatérales, aux manques d’explication. Il est également probable que la charge émotionnelle des managers s’intensifie. Ils deviennent les premiers réceptacles des inquiétudes individuelles, des tensions d’équipe, des interpellations syndicales. Sans soutien, la surcharge managériale peut basculer en usure, voire en décompensation. Les délégués syndicaux, de leur côté, peuvent adopter une posture plus combative, moins conciliante, parce qu’ils se sentent mis sous pression par leurs mandants, par leurs organisations syndicales, par les enjeux politiques. Cela ne signifie pas qu’ils deviendront systématiquement “radicaux”, mais que la marge de compromis peut se réduire. Enfin, les secteurs déjà sous tension – comme la chimie – peuvent devenir des locomotives sociales, dont les mobilisations inspirent d’autres secteurs. Les entreprises qui ont un climat déjà fragile sont alors plus exposées à des préavis de grève, des arrêts de travail ponctuels, des blocages informels ou des actions symboliques.
Le modèle Patrick Namotte™ des 4 niveaux de stabilité sociale
Pour aider les dirigeants, DRH et managers à se situer, je propose une grille de lecture simple, que j’utilise fréquemment en intervention : le modèle des 4 niveaux de stabilité sociale.
Niveau 1 : paix sociale superficielle (l’illusion du “tout va bien”)
Ici, il n’y a pas de conflit apparent, peu de revendications formelles, peu de remontées syndicales. On pourrait croire à une paix sociale solide. En réalité, les collaborateurs n’osent plus s’exprimer, les irritants sont tus, les problèmes se règlent en coulisses. C’est une paix “par peur” ou par résignation. Dans un contexte comme celui que nous vivons, ce type de “paix” peut basculer brutalement en crise dès qu’un élément déclencheur survient.
Niveau 2 : paix sociale fragile (les signaux faibles sont là)
Les tensions apparaissent par petites touches : remarques cyniques, critiques informelles, micro-conflits, demandes d’explications répétées. Le management perçoit des irritations mais ne les traite pas toujours. La concertation existe, mais reste partielle ou formelle. La paix sociale tient encore, mais elle se fissure. C’est à ce niveau que l’intervention est la plus efficace : médiation, diagnostic social, travail sur la communication interne, clarification des règles du jeu.
Niveau 3 : paix sociale constructive (équilibre dynamique)
Les tensions ne disparaissent pas, mais elles sont nommées, reconnues et traitées. La direction accepte la contradiction, les délégués syndicaux jouent un rôle de partenaires de dialogue, les managers sont accompagnés. Les désaccords ne sont pas niés, mais intégrés dans un dialogue social structuré. C’est le niveau où la paix sociale devient un facteur de résilience.
Niveau 4 : paix sociale stratégique (avantage compétitif)
Au niveau le plus avancé, la paix sociale est pensée comme un actif stratégique. L’entreprise anticipe, investit dans la QVCT, la RSE, la formation des délégués syndicaux, le leadership participatif, la culture de feedback, la prévention des conflits collectifs. Le climat social durable devient un vecteur de productivité, d’attractivité, de continuité des opérations et de réputation positive.
Scénarios probables pour la paix sociale 2025-2027
À partir de ce modèle et du contexte actuel, plusieurs scénarios peuvent être envisagés pour les prochaines années. Un premier scénario – optimiste mais réaliste – est celui d’une stabilisation négociée. Les réformes se poursuivent, mais sont compensées par des accords d’entreprise, des aménagements de fin de carrière, des améliorations ciblées des conditions de travail. Les entreprises qui investissent dans leur gouvernance sociale parviennent à maintenir une paix sociale constructive, malgré un environnement difficile. Un second scénario – plus tendu – est celui d’une succession de pré-crises. Les tensions ne débouchent pas toujours sur des grèves ouvertes, mais elles génèrent une usure des équipes, une méfiance durable, une augmentation des risques psychosociaux, une dégradation lente du climat social, une érosion de la confiance. Un troisième scénario – plus préoccupant – est celui d’une polarisation croissante. Les réformes, les discours politiques et les inégalités perçues alimentent des mobilisations plus fréquentes, des conflits récurrents, une judiciarisation de certains dossiers, une perte de repères pour les managers. Les entreprises qui n’auront pas investi dans la pacification des relations de travail risquent alors d’être particulièrement exposées. Dans la réalité, on observera probablement un mélange de ces scénarios, selon les secteurs, les cultures d’entreprise, les styles de management et la maturité du dialogue social.
Ce que les managers doivent absolument retenir pour préserver la paix sociale
Pour les managers, ce contexte peut sembler écrasant. Pourtant, leur rôle n’a jamais été aussi important. Sans se transformer en experts du droit social ou en médiateurs, ils doivent intégrer quelques idées essentielles. D’abord, que la paix sociale ne signifie pas l’absence de tension, mais la capacité à gérer les désaccords sans rupture. Il est normal que les collaborateurs expriment des inquiétudes ou des résistances ; ce n’est pas un échec du management, mais un signe que le réel s’exprime. Ensuite, que la posture managériale devient centrale : être clair sans être brutal, à l’écoute sans être complaisant, cohérent dans ses décisions, capable d’expliquer le “pourquoi” des choix. Dans le contexte actuel, les équipes détectent très vite les incohérences. La cohérence managériale est un pilier de la confiance. Enfin, que les managers ne doivent pas être laissés seuls. Ils ont besoin d’être soutenus par leur direction, formés aux relations sociales, accompagnés dans les situations sensibles, épaulés lorsqu’ils se retrouvent face à des délégués syndicaux en tension ou à des équipes épuisées. Un manager isolé est un manager en danger – pour lui-même, mais aussi pour la paix sociale.
Comment sécuriser concrètement la paix sociale dans ce contexte ?
Sécuriser la paix sociale aujourd’hui ne relève plus du “confort”, mais de la survie organisationnelle. Il ne s’agit pas de rêver un consensus permanent, mais de mettre en place des conditions permettant de traverser les turbulences sans rupture. Cela passe par une communication interne plus structurée, qui explique, contextualise et assume les décisions ; par un dialogue social plus mature, qui ne se contente pas de gérer les crises, mais anticipe les sujets sensibles ; par un investissement dans la formation des délégués syndicaux, en respectant leur indépendance, mais en améliorant la compréhension mutuelle des enjeux ; par le recours, lorsque c’est nécessaire, à un médiateur social ou à un tiers neutre, pour sortir de la logique d’affrontement et restaurer des relations sociales sereines. Les entreprises qui prennent ces sujets au sérieux, qui s’outillent, qui acceptent de se faire accompagner, obtiennent généralement des résultats tangibles : réduction des absences, meilleure mobilisation, moins de conflits ouverts, relations sociales plus professionnelles, capacité renforcée à traverser les restructurations.
La paix sociale comme stratégie de résilience
La situation politique, économique et sociale actuelle ne condamne pas les entreprises à la crise. Mais elle modifie profondément les conditions dans lesquelles se construit la paix sociale. Là où, hier, une gestion “correcte” suffisait, il faut désormais une gestion plus consciente, plus structurée et plus professionnelle des relations sociales, du dialogue social et de la concertation. La paix sociale n’est plus un simple “bonus” : elle devient un avantage stratégique, un élément central de la résilience, de la performance collective, de l’attractivité et de la pérennité. Les entreprises qui l’auront compris tôt disposeront, demain, d’un véritable avantage concurrentiel.
👉 Transformez votre paix sociale en avantage stratégique !
Si votre organisation ressent déjà des tensions, si vos managers se sentent en difficulté, si votre climat social devient plus fragile, ou si vos relations avec les délégués syndicaux se tendent, il est probablement temps d’agir avant que la situation ne bascule en pré-crise ou en crise ouverte. J’accompagne les entreprises et les équipes de direction depuis plus de 40 ans dans la gestion de leurs relations sociales, en Belgique, avec une expertise rare en matière de mandataires syndicaux, de concertation sociale, de médiation et d’intervention en contexte de tension ou de grève. Mon approche est neutre, confidentielle, orientée solutions et adaptée à la réalité de chaque organisation. 📩 Contactez-moi pour un diagnostic professionnel de votre situation sociale. Ensemble, nous pouvons transformer une paix sociale fragile en une paix sociale constructive, puis en un levier stratégique pour votre entreprise.
Paix sociale en entreprise : questions essentielles à retenir
Qu’est-ce que la paix sociale en entreprise dans le contexte actuel?
Comment la conjoncture économique actuelle fragilise-t-elle la paix sociale?
Quel est l’impact des discours politiques de droite ou d’extrême droite sur la paix sociale?
Les discours stigmatisants visant certains bénéficiaires de la sécurité sociale renforcent la polarisation, fragilisent la cohésion interne, la solidarité au travail et l’esprit d’équipe, même lorsque l’entreprise n’est pas directement visée.
Comment les managers peuvent-ils préserver la paix sociale en entreprise?
Les managers contribuent à la paix sociale en développant une posture cohérente, en expliquant le “pourquoi” des décisions, en traitant les irritants du quotidien et en étant soutenus par leur direction dans la gestion des tensions sociales.
Quand faut-il faire appel à un intervenant externe ou à un médiateur social?
Il est pertinent de faire appel à un médiateur social lorsqu’apparaissent des signaux faibles récurrents, une multiplication des tensions ou une perte de confiance entre acteurs, afin de prévenir le basculement en pré-crise ou en crise ouverte.